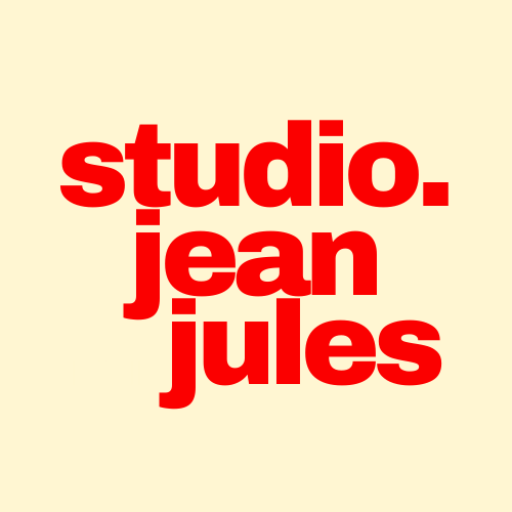Première femme à s’imposer dans l’atelier métal du Bauhaus, Marianne Brandt a bousculé les codes d’un univers dominé par les hommes. Théière, lampes industrielles, photomontages critiques : son œuvre incarne la modernité fonctionnelle et expérimentale de l’école. Longtemps oubliée, elle est redécouverte dans les années 1980. En 2024, l’un de ses tout premiers objets, un infuseur à thé, a été adjugé à 340 000 euros. Un record pour un objet du Bauhaus.
Marianne Brandt voulait être peintre. À son retour de Paris, quand elle découvre le Bauhaus, elle brûle ses toiles. Elle veut créer autrement.
Elle intègre l’école en 1923, alors âgée de 31 ans. Très vite, son professeur László Moholy-Nagy repère son talent et la décrit comme sa meilleure élève.

La première femme à intégrer l’atelier métal
Comme toutes les étudiantes, on l’oriente vers le textile. Elle refuse. Son objectif, c’est l’atelier métal, jusqu’alors réservé aux hommes. Elle s’y impose grâce à son obstination et au soutien de Moholy-Nagy. Mais l’accueil est brutal :
« Il n’y avait pas de place pour les femmes dans l’atelier. Je devais me battre et on m’attribuait constamment des tâches ennuyeuses et ingrates. Ainsi, j’ai martelé une infinité de demi-sphères en argent. À l’époque, je pensais que c’était normal et que tous les débuts sont difficiles. Rétrospectivement, mes professeurs ont expliqué qu’ils l’avaient fait pour exprimer leur désapprobation. »
Elle encaisse et apprend. Elle invente des théières, des lampes, des cendriers. Des objets simples, fonctionnels et radicaux, dans la ligne de pensée du Bauhaus.

Une femme à la tête de l’atelier
En 1928, Moholy-Nagy quitte l’école. Brandt lui succède à la tête de l’atelier métal. Une première historique mais sans titre officiel.
Elle négocie avec les fabricants, ajuste les modèles, supervise les prototypes. Entre 1928 et 1932, sa lampe Kandem, conçue avec Hin Bredendieck, s’écoule à 50 000 exemplaires.
Brandt joue un rôle clé dans l’entrée du Bauhaus dans l’industrie et l’essor du design moderne.

Une légitimité contestée
Malgré ses réussites, elle reste une femme dans un univers d’hommes. On doute de sa légitimité et on met en cause sa force physique. Les tensions montent, d’autant que ses camarades veulent orienter l’atelier vers le mobilier.
Contrairement à Gunta Stölzl, qui dirige alors l’atelier textile, un espace où les femmes sont nombreuses, Marianne Brandt est la seule à tenir les rênes d’un atelier masculin. Sa position exceptionnelle attise jalousies et critiques. En 1929, elle présente sa démission.
Oubli et redécouverte
Après son départ, Marianne Brandt poursuit brièvement sa carrière. Elle travaille un temps chez Walter Gropius à Berlin, puis chez l’industriel Ruppel à Gotha, où elle conçoit notamment une horloge devenue culte. Mais la crise économique puis la montée du nazisme brisent son élan. Interdite d’adhérer à la chambre des artistes, elle continue à créer dans l’ombre, dans la pauvreté et l’isolement.
Après la guerre, elle reprend l’enseignement, à Dresde puis à Berlin, transmettant son exigence et son regard à une nouvelle génération de designers.
Il faudra attendre la fin des années 1970 et le début des années 1980 pour que son œuvre soit redécouverte. Son travail est de nouveau exposé en 1976, alors qu’elle a plus de 80 ans. Elle meurt en 1983.
En 2024, un infuseur à thé qu’elle avait conçu à ses tous débuts a été adjugé 340 000 euros. Un record absolu pour un objet du Bauhaus.

Bien plus qu’une « fille à la théière »
Aujourd’hui encore, on associe souvent Marianne Brandt à sa théière iconique.
Mais elle fut bien plus que cela : une pionnière, une directrice d’atelier, une figure de l’industrie naissante, une photographe et une critique lucide de son temps. Marianne Brandt a marqué l’histoire du design. Au fer rouge.


pour Lire les autres articles de la série
« les femmes du bauhaus,